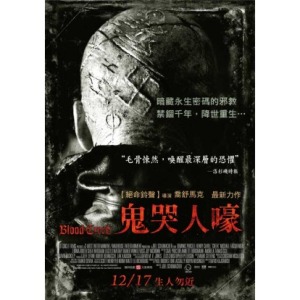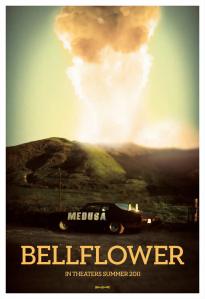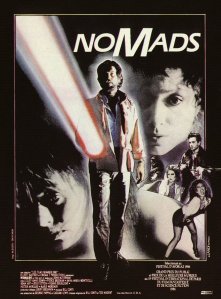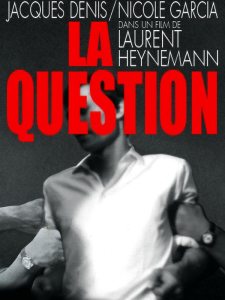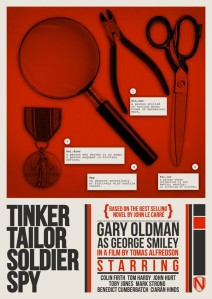Je vous propose, à l’occasion, un récapitulatif des films que j’ai visionnés sur une semaine et de vous en donner une lecture, à la fois critique, partiale et plus ou moins succincte, selon ce que les films m’inspireront au fil de l’écriture de ces billets, que je souhaite les plus spontanés possible. J’espère parfois vous donner envie ou vous dégoûter, selon chacun, chacune et chaque film…
Dans la mesure du possible, je m’abstiendrais de dévoiler trop des films, sauf quand j’estimerai qu’ils font partie du patrimoine cinéphilique obligatoire (j’exagère bien entendu), ou bien lorsque mon propos ne pourrait se passer, pour être limpide, d’explications précises, ou bien aussi lorsque je n’aurai que trop peu d’estime pour le film en question.
Encore une semaine peu fournie, qui démarra fort mal sur un « presque » navet, mais qui continua avec deux films très bons, chacun avec ses qualités et des discours différents.
Mardi 20 mars
Blood Creek (réal. Joel Schumacher, 2009)
Je n’ai jamais été vraiment convaincu du talent de Schumacher, mais je dois avouer que certains films au fil de sa carrière ont su me séduire : Génération perdue (question bête de nostalgie), L’Expérience interdite (un peu la même chose…), Chute libre (là c’est déjà plus sérieux et abouti), Tigerland (belle première prestation de Colin Farrell), Phone Booth (drôle de huis clos plutôt réussi). Mais combien de films imparfaits inintéressants, ratés ou à la morale plus que douteuse (Batman Forever, Batman & Robin, 8mm, Le Nombre 23 pour ne citer qu’eux…). Alors quand j’ai repéré ce direct-to-video pour la France, j’avoue que j’étais à la fois curieux et aussi très réticent, une fois le synopsis lu. Et bien l’on peut dire que je n’ai pas été déçu… ou plutôt j’aurais préféré que mes craintes le soient ! Basé sur un scénario indigent, dont la plausibilité (même pour un film à l’univers fantastique) est quasi nulle, Blood Creek est l’exemple même de films de série B mauvais, comme les américains en produisent malheureusement beaucoup trop et qui nous arrivent chaque année dans des sorties vidéos, qui généralement ne sont pas distribuées ailleurs que dans les bacs de DVD à petits prix des grandes surfaces. Mais voilà, avec Schumacher au commande, même si le film a échappé à une sortie salles, il a eu les bénéfices d’une sortie DVD/Blu-ray (si, si !) un peu mieux servi que ses habituels congénères, avec une présence à la FNAC entre autres (cela dit, loin de moi l’idée de dire que tout film vendu à la FNAC serait d’une qualité minimum…). Tout cela pour dire que ce film est truffé d’idées de mauvais goût, que la mise en scène est molle (qu’est-il arrivé au réalisateur de Chute libre ?), le montage inconsistant (la scène de combat final est à ce titre un summum de l’étirement narratif irréaliste) et rempli de situations à la limite du ridicule tellement elles en deviennent risibles (la « mémorable » attaque du cheval zombie dans la cuisine vaut presque à elle seule le détour). Pour finir sur une note bien malheureuse, espérons que la récente reconnaissance professionnelle, dont jouit Michael Fassbender après des rôles aussi prestigieux que ceux de Shame, A Dangerous Method, ou encore Hunger, lui permette d’éviter à l’avenir de jouer à nouveau dans des films aussi misérables que celui-là…
Mercredi 21 mars
38 témoins (réal. Lucas Belvaux, 2012)
Huitième film du cinéaste d’origine belge, 38 témoins est adapté d’un livre de Didier Decoin, Est-ce ainsi que les femmes meurent ?, et propose d’explorer le sujet de la culpabilité. Témoin d’un meurtre, pour lequel il n’a rien fait, pas même appeler la police, comme 37 autres personnes de son voisinage, Pierre Morvand (excellent Yvan Attal) est rongé par sa double culpabilité : n’avoir rien fait et ne pas oser l’avouer. Confronté à ce que cette double absence d’humanité révèle de lui, il finira par aller voir la Police pour rechercher la justice, non pas celle du meurtre, mais celle qui doit s’intéresser à lui. Contrairement aux autres témoins qui auront affirmé officiellement n’avoir rien vu, ni rien entendu, Pierre ne dira rien aux autorités, il jouera aux abonnés absents et ne mentira qu’à sa femme. Il est plus profondément rongé par la culpabilité de son inaction cette nuit-là que par son incapacité à l’avouer, puisqu’il finira par le faire en pleine nuit à celle qu’il aime. Conscient de ce que cet aveu va révéler d’inhumain en lui (il utilise d’ailleurs lui-même ces mots), il a compris qu’à partir du moment où il n’a rien fait, il s’était condamné, lui, son couple, sa vie future, à vivre en sursis, dans l’attente d’un jugement qui ne semble pas venir et dont il a désespérément besoin. Il le dit lui-même à la journaliste (Nicole Garcia très bien choisie pour ce rôle) : il erre entre les vivants et les morts. Lucas Belvaux soigne très bien l’écriture de son film et sa lente progression vers deux issues inéluctables qui sont autant d’étapes du film : l’aveu de Morvand à la Police et la reconstitution du meurtre (non pas pour mieux comprendre comment le meurtre s’est déroulé, mais surtout pour mieux comprendre comment 38 personnes en arrivent à ignorer les souffrances d’une autre). L’aveu et les scènes qui l’entourent (la préparation de Morvand qui endosse son plus bel uniforme de marin pour aller affronter ses démons et dire la vérité) sont le point de bascule du film. Belvaux ne s’y trompe pas et traite radicalement sa mise en scène à ce moment là. Si auparavant, Morvand et sa fiancée habitent le cadre ensemble et leurs regards peuvent s’y croiser, ce n’est désormais plus le cas. Leurs regards ne se croisent que dans l’espace du montage, dans les champs-contrechamps, mais plus dans le même cadre. Dès lors, dans un plan donné, leurs regards sont opposés ou regardent dans la même direction, mais il ne leur est plus possible de se regarder directement. Ce n’est que l’annonce à venir d’une rupture impossible à éviter. Belvaux filme la culpabilité et son irrépressible engrenage avec le calme qui sied aux drames humains et aux décors emplis du désespoir du Havre et de la haute mer. Sur les étendues sans fin de la mer, face aux supercontainers que Morvand pilote à bon port jusqu’au Havre, c’est la désolation de son âme qu’il contemple. Comme ce labyrinthe que sa fiancée parcourt sans sembler savoir où elle est destinée à arriver, sauf face à l’homme qu’elle a aimée, mais qui n’est plus que l’ombre de lui-même. La résolution finale, sans arriver à approcher la vérité d’une expérience odieuse, être témoin du meurtre d’une femme et ne RIEN faire, parle avant tout de l’incapacité de nos sociétés modernes à appréhender la lâcheté collective. Belvaux parle ici de la faillite des sociétés humaines face à l’horreur du mal, de la facilité de l’oubli et du déni, mais de du mensonge caractérisé que serait leur capacité à soulager l’homme.
Dimanche 25 mars
Bellflower (réal. Evan Glodell, 2011)
Scénariste, monteur, acteur, réalisateur, Evan Glodell montre avec Bellflower, son premier long métrage, les prémisses d’un véritable talent. Le film raconte les mésaventures de deux amis obnubilés par un avenir apocalyptique à la fois redouté et désiré, qui les propulserait, eux, leur lance-flammes fabriqué et leur voiture remaniée en engin de guerre, dans une version de Mad Max modernisée. Mais en attendant que la prophétie se réalise, il faut bien vivre, tomber amoureux, essayer de se construire une vie, un avenir bien réel… Après un accident de la route, suite à la découverte d’un adultère, l’un d’entre eux, gravement blessé, va plonger dans les affres d’une vie résiduelle sans promesse de lendemains heureux. Ce sera l’occasion de contempler une vengeance à la violence extrême et la déchéance de ses rêves. On se retrouve face au récit de voyage intimiste dans l’amitié et l’amour de jeunes américains paumés dans leur banlieue californienne, rêvant d’un monde chamboulé qui leur permettrait (peut-être) de donner un sens à leur vie et leurs fantasmes. Le film est porté par une narration globalement classique, mais qui ne s’interdit pas des ellipses significatives, à la fois surprenantes et en même temps très efficaces : le temps passé entre un plan où le jeune couple se découvre et le suivant où ils habitent ensemble et l’homme a une barbe bien fournie, en dit long sur ce qui a pu exister entre eux ; mais en même temps la description rapide du quotidien et de l’environnement – identique d’un plan à l’autre – traduit bien l’immobilisme face auquel le spectateur est confronté. La narration est aussi éclatée sur quelques moments du film, en particulier la fin et le fantasme de vengeance, dont les plans finissent par s’intercaler avec la fin réelle du film et des plans de flash-backs. Coproduit par une bonne partie du casting, ce film indépendant américain, repéré à Sundance, fait l’effet d’une révélation de talents divers et variés. D’abord les comédiens sont tous convaincants et le jeu tout en subtilité des uns et toute en force des autres donne au film un dynamisme qui colle parfaitement à l’écriture. La réalisation, si elle n’est pas particulièrement inspirée, est quand même bien efficace et s’appuie intelligemment sur un traitement de l’image très poussé, qui permet certainement aussi par moments de cacher un certain amateurisme ou de manque de moyens dans la prise de vue. Rappelant les effets popularisés par les applications de smartphones, comme Hipstamatic ou le TiltShift, la photographie est triturée, saturée, décolorée, retouchée, tout au long du film (ce qui est un peu épuisant visuellement sur la longueur). Cependant ces effets sont intelligemment utilisés : tel personnage ou tel autre semble bénéficier lors des plans qui lui sont consacrés d’une colorimétrie particulière. L’effet TiltShift produit une mise en avant intéressante, rarement vue au cinéma, en isolant une zone de netteté entourée de flou au sein d’une même profondeur de champ de l’image, là où d’habitude on a l’habitude que les jeux sur flou et net se situent dans la profondeur elle-même, entre un premier plan, un plan moyen et un arrière plan de l’image. Elle permet au réalisateur d’attirer l’attention du spectateur sur tel ou tel élément de l’image, tout en renouvelant quelque peu les procédés habituellement utilisés.