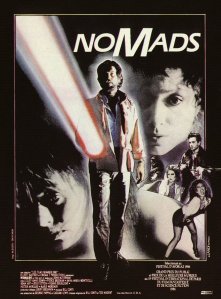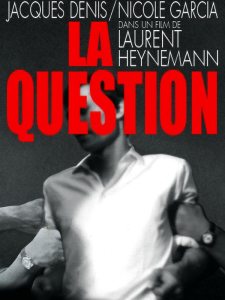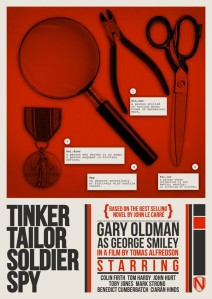Je vous propose, à l’occasion, un récapitulatif des films que j’ai visionnés sur une semaine et de vous en donner une lecture, à la fois critique, partiale et plus ou moins succincte, selon ce que les films m’inspireront au fil de l’écriture de ces billets, que je souhaite les plus spontanés possible. J’espère parfois vous donner envie ou vous dégoûter, selon chacun, chacune et chaque film…
Dans la mesure du possible, je m’abstiendrais de dévoiler trop des films, sauf quand j’estimerai qu’ils font partie du patrimoine cinéphilique obligatoire (j’exagère bien entendu), ou bien lorsque mon propos ne pourrait se passer, pour être limpide, d’explications précises, ou bien aussi lorsque je n’aurai que trop peu d’estime pour le film en question.
Guère plus de films cette semaine (seulement quatre), mais il n’y a là, chacun dans leur genre (comédie, polar, drame, guerre), que des films que je recommande très chaudement à vous lecteurs, à voir pour ceux qui ne les auraient pas vus ou à revoir sans hésitation…
Mardi 27 mars
La Cité de la peur (réal. Alain Berbérian, 1994)
Cela faisait bien longtemps que je n’avais pas revu « le film de les Nuls » (comme on dit), il n’a pas vieilli et reste toujours aussi drôle. L’équipe des Nuls, sans Bruno Carette bien entendu (à qui il est rendu hommage par le biais de son personnage Misou-Mizou), revient sur son humour habituel, fait de références extérieures (certaines mêmes à leur propres sketches), d’humour absurde et nonsensique (largement inspiré par le Saturday Night Live et les ZAZ) et de digressions visuelles et narratives. Il n’y a quasiment pas un plan du film qui ne contienne un gag ou une ligne de dialogue comique et l’on passe en revue toutes leurs habituelles formes humoristiques : la fausse pub, les gags visuelles (Odile à l’aréoport de Nice), les running-gag (le vomi de Simon), etc. Je ne me hasarderais pas à passer en revue toutes les répliques cultes que ce film a produit (« –Du whisky ? –Juste un doigt. –Vous voulez pas un whisky d’abord ? ») ; mais si je ne devais retenir qu’une seule scène de tout le film, il s’agirait sans hésitation de la scène de danse de la Carioca entre Chabat et Darmon, qui, non seulement de me faire plier de rire, ne peut s’empêcher de me donner envie de danser et de pousser la chansonnette… Merci les Nuls !
Jeudi 29 mars
Breaking News (réal. Johnnie To, 2004)
Découvert à Cannes en Hors-compétition, le film de Johnnie To m’avait laissé « scotché » sur mon fauteuil dès la première scène du film et régulièrement depuis lors, il m’arrive de ne regarder que cette scène, pour le simple plaisir de revenir à ce qui m’a séduit en tout premier dans le cinéma : l’inventivité visuelle de la mise en scène et des mouvements de caméra, que cela passe par le montage ou pas (comme c’est le cas ici). En effet, cette première scène est un très long plan séquence qui commence sur une action posée (une rue avec une activité urbaine classique) pour se transformer en véritable champ de bataille entre voyous et policiers. À la différence d’un Michael Mann dans Heat et sa scène de fusillade en pleine ville, que le réalisateur découpe minutieusement pour bien « expliquer » la topographie des lieux et les enjeux scénaristiques qui en découlent, To va lui au contraire faire le choix d’une unité de lieu, de temps et d’action. Cela va lui permettre de poser un discours, dès les premières minutes de son film, sur le filmage du polar à Hong Kong. Si ce discours avait déjà été abordé dans ses précédents films (on pense ici à The Mission, Running out of Time ou Fulltime Killer), jamais jusqu’à présent le cinéaste ne concentrera autant de points de vue formels sur la question. Pour faire comprendre son amour et rendre hommage bien sûr, To ne pastiche pas formellement ses maîtres à penser (ou plutôt à filmer) que sont Tsui Hark, Jonh Woo, pour ne citer que les plus célèbres à l’Occident, il préfère démonter l’action en allant à l’opposé de son traditionnel traitement. Ici très peu de ralentis, quasiment pas de surdécoupage des plans. Si John Woo dans certaines scènes de À toute épreuve enchaîne les plans avec plus de rapidité (et d’élégance mais c’était évident) qu’un Michael Bay survitaminé, Johnnie To lui pose sa caméra dans les couloirs du building assiégé par les forces de police. Il la fait évoluer au milieu d’une rue où les tirs de pistolet s’échangent comme des quolibets (là aussi on est loin de la précision mortelle des tirs chez Hark ou Woo où un chargeur permet de dézinguer plus d’une quinzaine de types en même temps). Si l’on ajoute à tout cela la scène de cuisine dans l’appartement des otages, To passe en revue toutes les scènes clés d’un polar HK des années 80. Alors même si le sujet du film n’est pas transcendant (la critique de la médiatisation du fait divers tant par les médias que par la police et les voyous), le film reste un concentré d’action et de mise en scène magistrale au service d’une lecture limpide du récit.
Vendredi 30 mars
La Fleur du mal (réal. Claude Chabrol, 2002)
Je n’ai jamais beaucoup aimé les films de Chabrol, en particulier ceux des deux dernières décennies, mais il faut avouer que celui-ci m’a tout de suite plu. On y retrouve beaucoup de ses marottes : critique de la bourgeoisie provinciale (et celle de Bordeaux s’y prête à merveille), de ses mœurs et de ses fausses vérités, critique de la politique locale et de son hypocrisie mélangée à la sincérité avérée de ses représentants. Il y a là comme une schizophrénie inavouée que l’on cacherait en arpentant les soirées mondaines du Maire ou les escaliers communs des HLM. Chabrol évoque aussi l’héritage encore prégnant de l’Occupation, et plus particulièrement de la Collaboration, dans nos élites politiques et dans les rapports de force des composantes de la société civile bourgeoise de Province. À l’aide de comédiens très efficaces (Suzanne Flon, Bernard Le Coq, Isabelle Huppert, Benoît Magimel, Mélanie Doutey, Thomas Chabrol et des seconds rôles très bien distribués), le récit nous fait pénétrer dans les secrets et l’intimité quasi incestueuse de cette double famille bordelaise (les Charpin-Vasseur), où le mari trompe sa femme autant qu’elle semble le faire, où le demi-frère et la demi-sœur couchent ensemble (mais ne sont-ils pas un peu plus ? Une ligne de dialogue laisse le spectateur dans l’indécision), où une vieille femme, à qui l’on « donnerait le Bon Dieu sans confession » est la détentrice d’un lourd secret. Le plan final du film, sur lequel se déroule tout le générique, montre une action sans interruption : un cocktail à la maison familiale suite à la victoire aux Municipales de Mme Charpin-Vasseur). Alors que les convives semblent s’amuser, un cadavre gît à l’étage supérieur. Seul trois personnages sont au courant, ils sont le ferment d’un secret qui clôturera la boucle de l’Histoire avec la probable accusation de la vieille tante, pour ce meurtre qu’elle n’a pas commis, et pour une à laquelle elle a échappé. Il est intéressant de voir comment Chabrol joue avec la notion de secret et de son partage avec le public qui est placé directement devant l’hypocrisie des personnages renseignés. Très prochainement, je compte bien regarder Snake Eyes de Brian DePalma, où l’on reparlera certainement d’un plan final identique mais dont la construction de la résolution du « secret » est aux antipodes de Chabrol. Deux façons différentes d’envisager le secret comme ferment de la société : pour l’un il est à découvrir coûte que coûte, comme Saint-Graal de l’héritage de l’assassinat de Kennedy, pour l’autre il est la base d’une bourgeoisie sclérosée, consanguine et mortifère…
Dimanche 1er avril
Lebanon (réal. Samuel Maoz, 2009)
Premier long métrage de fiction de son réalisateur, Lebanon revient sur la Guerre du Liban, plus exactement sur les premiers jours de juin 1982 et l’équipage d’un tank israélien. Tout le film repose sur ce parti pris esthétique et cette idée d’un huis-clos inhabituel, l’intérieur d’un tank. Ce que le spectateur voit, à l’exception d’un ou deux plans au début et à la fin du film, ne se déroule qu’à l’intérieur du tank ou de temps à autre à l’extérieur, uniquement par le biais de ce que les personnages perçoivent de ce monde extérieur (via la visée du tank entre autres). Cette figure esthétique impose bien entendu un mode de filmage : beaucoup de gros plans, de champs/contrechamps, une lumière très réduite, donc un travail des ombres très accentués sur les visages et les corps (cf. la scène où les personnages doivent dormir avant l’assaut). Ensuite, elle impose aussi une narration particulière. Le spectateur ne connaît des événements qui entourent le tank que ce que ses « habitants » peuvent en capter. Ils sont enfermés à la fois dans leur certitude sur leur mission, mais aussi dans leur ignorance des enjeux et de la réalité (le tank comme armure face à la dangerosité extérieure). Cependant, en même temps, ils sont le centre de toutes les attentions puisqu’il détienne une puissance de feu sans commune mesure avec les fantassins. Maoz place ainsi son public dans une position double de protection et de faiblesse face aux émotions que les « tankistes » ressentent et expriment. On peut regretter par moment que la mise en scène appuie un peu trop le propose qu’elle illustre : la scène de la mère de famille désemparée après la mort des siens est légèrement trop insistante, en particulier lorsqu’à la fin de la scène, le champ/contrechamp entre son regard directement tourné vers le viseur du tank et celui du tireur renvoie en écho leurs propres désespoir face à la violence qui les entoure. Ce montage et ces plans n’avaient pas besoin d’être là pour faire passer le message. Quelques autres scènes sont traitées de façon similaire et l’on déplorera donc une insistance parfois naïve de la caméra. Mais le film est d’une redoutable efficacité quant à ce qu’il a à dire sur la Guerre, son impersonnalité autant que sa capacité à nouer de liens entre ceux qui doivent d’entraider pour survivre, mais surtout sur son invraisemblable logique et la violence outrancière qui en découle, au nom de la raison d’État.